|
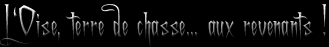
 |
A moins d’une
heure au nord de Paris, le département de l’Oise est la clef
d’entrée de la Picardie. Clairsemé de forêts domaniales, de
châteaux et d’étangs, ce vaste territoire de tradition royale et
cynégétique revêt à chaque hiver son manteau de brume. Inspiré
par des décors de contes de fées, Maison-Hantee.com est allé à
la rencontre des fantômes qui hantent les sous-bois aux couleurs
automnales, les jardins romantiques et les couloirs silencieux
des vastes demeures seigneuriales. De Chantilly à Compiègne en
passant par la cité médiévale de Senlis, l’atmosphère
aristocratique emmitoufle des secrets de famille que nous avons
cherché à décrypter. Empruntez la voie royale qui mène
directement au monde des spectres et des créatures fantastiques… |
Textes et photos
Olivier VALENTIN
Vous rêvez d’une échappée belle au cœur de
la France mystérieuse ? Avec sa variété de sites et son accessibilité
depuis Paris, l’Oise occupe une place privilégiée dans le carnet de
route du chasseur de fantômes. S’évader le temps d’un week-end, fuir la
cohue des boutiques en période de fêtes de fin d’année, s’habiller
chaudement pour des promenades hivernales et explorer des chemins
légendaires à la découverte d’un patrimoine naturel et historique haut
en couleurs. Telles furent mes aspirations à quelques jours de Noël.
Malgré un soleil démissionnaire, la météo fut relativement clémente pour
m’éviter brouillard, givre et verglas. Profitant d’une saison
touristique très tranquille et des nombreuses occasions de retraites au
coin du feu, j’ai déniché quelques lieux, remarquables par leur histoire
secrète, leur environnement ou l’extravagance de leur esthétisme. Suivez
le guide !
Les Blanches de
Commelle
La première adresse figure en bonne place
des châteaux hantés qui ont inspiré les écrivains romantiques.
Dans ses Mémoires d’outre-tombe,
Chateaubriand évoque l’étrange sentiment qui l’envahit aux abords du
Château de la Reine Blanche, vestiges d’un castel médiéval qui jouxte
les Etangs de Commelle, près de Coye-la-Forêt, au sud de Chantilly. Au
chapitre 2 de son livre 16ème, il écrit :
« Comme aux oiseaux voyageurs, il me
prend au mois d'octobre une inquiétude qui m'obligerait à changer de
climat si j'avais encore la puissance des ailes et la légèreté des
heures : les nuages qui volent à travers le ciel me donnent envie de
fuir.
 |
Afin de tromper cet instinct,
je suis accouru à Chantilly. J'ai erré sur la pelouse où de
vieux gardes se traînent à l'orée des bois.Quelques corneilles,
volant devant moi, par−dessus des genêts, des taillis, des
clairières, m'ont conduit aux étangs de Commelle. La mort a
soufflé sur les amis qui m'accompagnèrent jadis au
château de la reine Blanche
: les sites de ces solitudes n'ont été qu'un horizon triste,
entrouvert un moment du côté de mon passé. Aux jours de René,
j'aurais trouvé des mystères de la vie dans le ruisseau de la
Thève : il dérobe sa course parmi des prêles et des mousses ;
des roseaux le voilent ; il meurt dans ces étangs qu'alimente sa
jeunesse, sans cesse expirante, sans cesse renouvelée : ces
ondes me charmaient quand je portais en moi le désert avec les
fantômes qui me souriaient, malgré leur mélancolie, et que je
parais de fleurs. » (Novembre 1838) |
Gérard de Nerval fait aussi allusion à ce
lieu chargé d’émotion dans ses Promenades et souvenirs
(1854-1855) :
« Célénie m’apparaît souvent dans mes
rêves comme une nymphe des eaux, tentatrice naïve, follement enivrée de
l’odeur des prés, couronnée d’ache et de nénuphar, découvrant, dans son
rire enfantin, entre ses joues à fossettes, les dents de perles de la
nixe germanique.
|
Et certes,
l’ourlet de sa robe était très souvent mouillé comme il convient
à ses pareilles… Il fallait lui cueillir des fleurs aux bords
marneux des étangs de Commelle, ou parmi les joncs et les
oseraies qui bordent les métairies de Coye. Elle aimait les
grottes perdues dans les bois, les ruines des vieux châteaux,
les temples écroulés aux colonnes festonnées de lierre, le foyer
des bûcherons, où elle chantait et racontait les vieilles
légendes du pays ! – madame de Montfort, prisonnière dans sa
tour, qui tantôt s’envolait en cygne, et tantôt frétillait en
beau poisson d’or dans les fossés de son château. ». |
 |
Au pied de cet ancien moulin reconverti en
relais de chasse en 1825, à la demande du duc de Bourbon, dernier des
Condés, je suis frappé par l’enchantement des lieux. Cet édifice de deux
étages, flanqué de quatre tourelles crénelées et édifié dans le pur
style médiéval, est léché par une rivière qui s’écoule de l’étang. Si on
fait abstraction de la crêperie avoisinante - qui défie toutes les lois
de mise en valeur du patrimoine architectural de la région ! -, on se
prend à rêver à la légende qui donna son nom actuel au château.
Initialement baptisé "Logis de Viarme" du
temps des bûcherons, le bâtiment devint moulin de tanneur en 1426 et à
fouler le drap en 1533. En 1765, le prince de Condé en fit un moulin à
blé puis une manufacture de papier en 1787. Lorsque la propriété fut
vendue en 1823 à un certain Gandulphe Adryane, elle avait pour
dénomination "Moulin de la Loge de Viarmes". L’édifice principal, de
forme carrée à quatre niveaux, était flanqué de tourelles aux angles. Au
début du 19ème siècle, d’autres corps de bâtiment avaient été
construits, adossés aux faces nord et ouest, en tant que logement et
entrepôt (grains, meules, matériel et farine). Ces infrastructures
furent complétées d’écuries, étables, appentis et hangars.
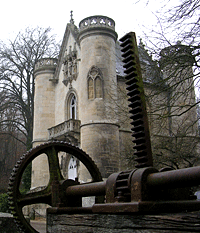 |
Le 25 mars 1825, le duc de Bourbon
acquit l’ensemble et chargea son architecte, Victor Dubois, de
le reconvertir en rendez-vous de chasse. Les deux derniers des
trois corps de bâtiments furent démolis pour ne laisser que le
pavillon carré, en fort mauvais état. Les tourelles furent alors
consolidées par des contreforts et coiffées de terrasses en
plomb dissimulées par des balustres ajourées en pierre sculptée.
Les fenêtres de forme ogivale, un balcon sculpté sur console à
tête d’animaux et l’encastrement de trois statues de chevaliers
vinrent compléter ce tableau d’inspiration troubadour. A
l’intérieur (qui ne se visite pas), les pièces sont voûtées, sur
croisées d’ogives en pierre, et abritent une cheminée basse, en
marbre blanc et aux motifs sculptées. |
Du pur style néo-gothique, très en vogue
au 19ème siècle, que l’on retrouvera plus tard au château de
Pierrefonds !
Comment cet édifice à usage multiple
a-t-il changé de nom ? Comme souvent, les archives régionales ne donnent
aucune réponse. Seule la tradition orale apporte des hypothèses.
Avant l’existence du "Logis de Viarmes"
aurait existé, à cet emplacement, un château édifié, selon les versions,
par Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, ou par Blanche de Navarre,
épouse de Philippe VI de Valois, un des rois maudits de Maurice Druon !
Une autre légende, plus romanesque, vient
nourrir les rumeurs de hantise qui entourent le site. Le château serait
situé à proximité d’une ancienne chaussée Brunehaut, du nom de cette
reine à qui un poème épique du 12ème siècle prête une
réputation diabolique. Imaginée sur son cheval au galop, dans un dédale
d’antiques voies de communication reliant autrefois des cités gauloises,
elle aurait fait construire ces routes pour mener plus rapidement ses
armées vers la mer et y aurait même trouvé la mort, traînée par sa
monture.
|
Son fantôme de Dame Blanche
hanterait-il toujours ce tracé légendaire dont le castel de
Commelle serait l’un des péages maléfiques ?
Je fais le tour du premier étang,
contemplant longuement le château de différents points de vue,
et croise quelques promeneurs, des habitués en cette saison !,
qui viennent se ressourcer, d’un pas flâneur ou au pas de
course, au milieu de ce décor mi-ocre, mi-brumeux. Ici, l’hiver
est en retard. A l’instar de ces corbeaux qui m’observent du
coin de l’œil - noir bien sûr ! -, le temps a suspendu son vol.
Je quitte la forêt de Coye,
direction Senlis, laissant derrière moi, la rêverie et le charme
d’une promenade fantastique qui mérite, à elle seule, le voyage. |
 |
Le fantôme de Chantilly
En route, je ne peux m’empêcher de marquer
une pause à Chantilly, hanté par le fantôme de Louise de Budos, seconde
femme d’Henri 1er, duc de Montmorency, connétable de France.
En février 1593, l’hôte de Chantilly se
rendit à Pézenas pour assister à l’enterrement de son dernier fils et y
rencontra une jeune et jolie veuve qu’il épousa le mois suivant. Dans
ses Mémoires, Saint-Simon rapporte qu’en 1598, Louise, délaissée
par son mari à Chantilly, fit plusieurs fois la rencontre d’un
mystérieux personnage. Or, le lendemain du jour où on la vit s’enfermer
avec cet inconnu dans un cabinet du château, elle fut retrouvée morte,
« par terre, le col entièrement tourné, le visage du costé de l’espine
du dos, sans estre pourtant défiguré, et dans le cabinet [flottait]
une odeur de souffre très puante ».
A ses funérailles, Henri Ier fut
violemment épris de la tante de Louise, Mme de Dizimieu, qui découvrit
le corps de sa nièce. Il la demanda en mariage trois mois plus tard.
Pourquoi une telle soudaineté à ces "coups de foudre" ? Toujours
d’après Saint-Simon, le duc fut victime d’un anneau enchanté, porté
successivement par Louise de Budos à qui une mendiante l’avait offert,
puis par sa tante, Mme de Dizimieu, qui l’avait pris sur son cadavre.
Ce talisman était capable de faire naitre chez la personne convoitée un
amour frénétique pour la femme qui le portait. Pour preuve, lorsque la
tante jeta l’anneau dans les jardins d’Ecouen, le charme fut rompu et le
duc de Montmorency divorça.
Dès lors, le spectre de Louise fit son
apparition au château de Chantilly. De funeste augure, il se manifesta
chaque fois pour présager le décès du maître des lieux. Peu de temps
avant la mort de « l’aisné de la Maison de Condé » (sans doute le
prince de Conti, Louis-Armand Ier, en 1685), elle apparut à la fenêtre
de la salle d’Armes. L’écuyer du prince, Vervillon, témoin du phénomène,
chercha à éclaircir le mystère, en vain. Mais peu de temps après, le
prince fut foudroyé par la petite vérole. Accomplissement de la funeste
prophétie liée au fantôme de Chantilly ou contamination à Fontainebleau
par son épouse, « bâtarde de Louis XIV » (Marie-Anne ?), qui
avait contractée la même maladie ? Quoi qu’il en soit, les circonstances
étranges qui entourent la mort de Louise de Budos peuvent accréditer la
thèse d’une hantise.
Avant de faire route pour le château de
Raray, bien connu des admirateurs de Jean Cocteau, je m’arrête à Senlis
pour enquêter sur les mystères de la chapelle royale Saint-Frambourg, à
deux pas de la cathédrale.
La crypte magnétique de
Senlis
 |
Restaurés par la Fondation Cziffra
(du nom du célèbre pianiste Georges Cziffra), les vestiges de
cette église du 12ème siècle n’en finissent pas de faire parler
d’eux depuis les fouilles archéologiques de 1974 qui mirent à
jour un escalier dans la base du clocher disparu. Scénario rêvé
pour les amateurs de romans gothiques, cet escalier conduit à la
petite chapelle fondée par Adélaïde, épouse d’Hugues Capet, vers
993, sur l’emplacement supposé d’un temple de Minerve, déesse
romaine de la sagesse ! |
Dans les entrailles de cette crypte, on
découvrit un sarcophage mérovingien, contenant vraisemblablement les
reliques de Saint-Frambourg à qui le lieu est dédié, ainsi qu’un tombeau
attribué à Adélaïde. Mais, à ce jour, les historiens ne possèdent aucune
preuve sur l’identité des dépouilles qui reposent à Saint-Frambourg.
Pourtant, ce doute n’ôte pas au lieu sa réputation thaumaturgique. En
effet, des fluides magnétiques qui le traversent soigneraient bien des
maux. Sans parler des légendes de hantises, soulevées par la veuve
Cziffra, présidente de la Fondation !
Ces suppositions méritent une enquête
approfondie ! Hélas, je n’obtiens aucun mandat pour perquisitionner la
crypte. En hiver, la Fondation n’est ouverte que les dimanches
après-midi, de 15h à 17h. Affaire à suivre…
Chasse fantastique à
Raray
|
Depuis Senlis,
on peut rejoindre Raray par la départementale qui mène à
Compiègne. Pour cela, il ne faut pas manquer la D26 à la hauteur
d’Ognon. On peut aussi suivre la N324 qui fait route vers
Crépy-en-Valois. Des panneaux indiquent le Château de Raray dont
l’aspect actuel date du 17ème siècle. Aujourd’hui, ce
monument historique abrite un restaurant gastronomique, un hôtel
de luxe, un golf, un bar et des salles de réunion, cadre idéal
pour un séminaire d’entreprise ou un séjour haut de gamme.
A mon arrivée,
je suis déçu par la flotte de véhicules qui bordent les deux
célèbres haies cynégétiques, de part et d’autre de la cour, face
à ce prestigieux château. Il y a en effet plusieurs conventions
professionnelles ce jour-là. Le charme des décors du film La
Belle et la Bête de Jean Cocteau a donc du mal à agir…
d'entrée de jeu ! |
 |
Mais je suis fort bien accueilli par le
responsable du restaurant qui m’invite à consulter les photos du
tournage dans le hall et à flâner dans le parc (en évitant les greens du
golf !) jusqu’à la Porte de Diane dont les ornements évoquent la chasse
fabuleuse de la Licorne. Animal sauvage emblématique de la littérature
fantastique, la Licorne ne peut être approchée que par une vierge. C’est
ce que prétend le premier épisode du célèbre conte écrit en 1757 par
Madame Leprince de Beaumont et dont Jean Cocteau tira la remarquable
adaptation cinématographique de 1945 avec Jean Marais et Josette Day.
 |
Dans ce chef d’œuvre, Cocteau
sublime avec poésie et mystère les deux haies d’arcades dont les
dix-huit niches abritent les bustes d’empereurs romains,
d’impératrices et de dieux de l’Olympe. Les sculptures
animalières qui les surmontent rendent hommage aux protagonistes
de la chasse : plus de quarante chiens, un sanglier et un
magnifique cerf que chevauche la Bête (Jean Marais) dans une
scène du film. On doit tout ce bestiaire féérique au conseiller
de Louis XIII, Nicolas de Lancy, Chambellan du Duc d’Orléans,
qui acquit la propriété au début du 17ème siècle.
Cousine des Lancy, Madame de Sévigné a même arpenté ces allées
de pierre. |
En me replongeant dans le livre de Simon
Marsden, Journal d’un chasseur de fantômes, je découvre que le
château de Raray est le théâtre d’une hantise dont même les golfeurs se
plaignent.
|
Un réalisateur
de cinéma, passionné par le fantastique et le surnaturel, avait
confié à Marsden que le château était hanté par le fantôme d’une
jeune servante et de son petit garçon qu’elle a tenté
d’assassiner avant de se pendre à un arbre du parc. Alors qu’il
prenait des photographies de la Porte
Rouge (autre nom pour la Porte de Diane), Simon
Marsden échangea quelques mots avec un habitué du golf, aussi
sensible à la noblesse des lieux qu’à son atmosphère
ensorcelante. Ce dernier ne croyait pas aux fantômes mais resta
néanmoins perplexe au souvenir d’un incident qui toucha sa
petite fille de quatre ans. Il se rappela qu’elle avait eu peur
des statues car l’une d’elle avait bougé, « un petit garçon
dans les bois près de la porte » qui « n’était pas réel » !
A l’époque, le golfeur n’avait prêté aucune attention à cette
invention enfantine. Mais, depuis sa rencontre avec Marsden, un
spectre du passé s’était réveillé en lui… |
 |
Je prends quelques photos de la fameuse
porte et croise quelques golfeurs mais aucune trace d’un garçonnet
errant dans les bois à la recherche de sa mère. Néanmoins, cette visite
énigmatique me donne envie de revoir La Belle et la Bête…
La résurrection de
Pierrefonds
|
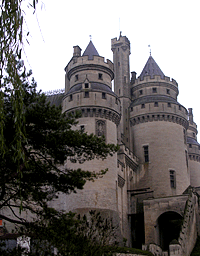 |
Sur la route de Pierrefonds,
village du sud-est de la Forêt de Compiègne, je constate que le
jour décline rapidement. J’espère avoir le temps de visiter
l’impressionnant château, restauré – ou plutôt réinventé ! – au
19ème siècle, par Viollet-le-Duc. Du 1er
septembre 2005 au 30 avril 2006, le monument ferme à 17h30 et la
billetterie quarante-cinq minutes avant.
Face à l’édifice, je suis
littéralement frappé par l’imaginaire romantique qui s’en
dégage, comme happé par un conte de Charles Perrault ! J’ai du
mal à contenir l’immensité du château sur une simple
photographie ! Je pense au peintre Jean-Baptiste Corot qui, en
1834, planta son chevalet, bien loin des ruines, pour embrasser,
d’un coup d’œil et de pinceau, la majesté de Pierrefonds. |
Je me hâte de faire le tour des imposantes
murailles pour gagner la cour intérieure et payer mon droit d’entrée.
Hélas, pas assez de visiteurs pour mobiliser un guide. Je m’apprête à
faire le tour du propriétaire, seul avec mon indigeste brochure
historique, lorsqu’un tout nouveau guide me propose de visiter une
partie rarement montrée au public, les caves voûtées ! Après plusieurs
portes capricieuses dont un bruyant trousseau de clefs vient à bout, je
pénètre dans la pénombre d’une succession de salles souterraines
peuplées de gisants fantomatiques, copies des originaux de la basilique
Saint-Denis.
|
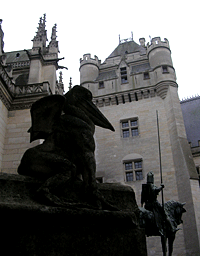 |
Mon guide privé
me fait remarquer sur le mur les traces témoignant des travaux
accomplis depuis la place forte initiale du 12ème
siècle, arrangée par Louis d’Orléans en 1393, démantelée
partiellement par Louis XIII en 1617 à la suite d’un siège, puis
restaurée par Viollet-le-Duc dès 1858. D’ailleurs, ce célèbre
architecte - qui a sa statue sur le toit de
Notre-Dame-de-Paris ! - a longuement hésité sur les parties à
reconstruire. Un an avant le début des travaux, il ne souhaitait
reprendre que le donjon, au milieu de ruines. Scrupule
d’archéologue qui craignait une restauration hypothétique ou
mode du pittoresque et du fantastique soutenue par les écrivains
romantiques ? Il est vrai que les gravures d’époque qui rendent
compte de la magie des ruines offrent à tout amateur d’histoires
de fantômes une source d’inspiration qu’il aurait été déplacé de
dénaturer. |
Mais, en 1861, la décision fut prise de
restaurer intégralement le site, en partie sur la "cassette"
personnelle de l’Empereur Napoléon III, pris d’une "folie romantique".
Les travaux se prolongèrent même après la mort de Viollet-le-Duc pour
aboutir en 1885 sans que la décoration intérieure n’en soit totalement
achevée.
|
Au milieu de
ces statues, habilement éclairées, j’ai comme l’impression que
plusieurs siècles de l’histoire de France me contemplent. Clou
de la visite inédite, le guide révèle, derrière une planche de
bois, un accès aux oubliettes. Au fond du trou qu’il m’éclaire à
la lueur de sa lampe-torche, j’aperçois un gant ! Je ne suis
donc pas le seul à avoir eu le privilège de visiter cette salle
secrète. Comme moi, le propriétaire du gant a dû apprendre qu’un
squelette de femme, datant de Philippe Auguste, propriétaire du
domaine en 1185, a été découvert dans ce puits lors de
fouilles ! |
 |
Observant les graffitis grattés sur le mur
par les anciens prisonniers de cette geôle, je demande au guide s’il a
entendu parler d’histoires de fantômes à Pierrefonds. « Pas à ma
connaissance, même si le personnel du château se plaint de fréquentes
mésaventures… » Je n’en apprends pas plus et m’abstiens de poser
d’autres questions, au risque de heurter la susceptibilité de mon hôte.
Mais la façon dont les prisonniers finissaient leurs jours dans ce "trou
à rat" me laisse imaginer quelques présences d’outre-tombe…
|
 |
Après ce coup
d’œil privilégié aux entrailles du château, je déambule
librement dans les
salles où tout se prête à la démesure : taille, architecture,
décoration, éclairage,… Cette sensation est amplifiée par la
présence de pièces de plomberie d’art, léguée par Madame
Pasquier Monduit. Les ateliers Monduit furent en effet impliqués
par les plus grands architectes (Viollet-le-Duc, Charles
Garnier, Bartholdi,…) dans la restauration ou la création
d’œuvres en plomb ou en cuivre célèbres comme la flèche de
Notre-Dame-de-Paris, la statue de la Liberté ou l’archange
Saint-Michel. A Pierrefonds, on peut admirer les doubles
véritables (et non les copies !) de ces œuvres d’art dont les
gargouilles de Notre-Dame-de-Paris, le Lion de Belfort ou le
Cupidon de la cathédrale d’Amiens. |
Dans la salle des Preuses, pièce d’apparat
du 1er étage de l’aile nord-ouest, qui me surprend par son
volume et son plafond en forme de coque renversée, je pense au faste des
réceptions du Second Empire. Sur le manteau d’une cheminée monumentale,
des statues de l’impératrice Eugénie et de ses dames de compagnie
m’observent. Comme j’allais l’apprendre plus tard, Pierrefonds et ses
nombreux appartements ont servi récemment de décor à la série TV des
Rois Maudits de Josée Dayan, diffusée en novembre dernier sur France
2.
Au rez-de-chaussée, la salle des gardes
abrite quelques vestiges archéologiques du 15ème siècle
ainsi qu’une remarquable maquette du château, réalisée en pierre par Wyganowski,
inspecteur des travaux de Pierrefonds.
|
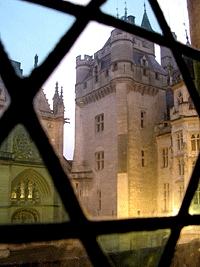 |
Dans la cour, je flotte comme un
fantôme au milieu des statues d’animaux fantastiques. Elles
soulignent l’attrait que l’architecte et son commanditaire
avaient pour l’imaginaire médiéval et le néo-gothique. La nuit
est tombée sur Pierrefonds. Je profite ainsi de l’éclairage
extérieur qui sublime le lieu. Ici, les perspectives se jouent
de l’ombre et de la lumière. L’ambiance irréelle qui en découle
abandonne peu à peu la forteresse à sa brume nocturne et son
cortège de mystères…
Quant à moi, je gagne mon hôtel à
Saint-Jean-aux-Bois, ravissant village au cœur de la forêt de
Compiègne, où toute l’équipe des Rois Maudits avaient élu
domicile pendant le tournage de Pierrefonds, le temps de
déguster foie gras, homard et autres spécialités de gastronomes
aisés (ou de producteur de cinéma peu scrupuleux…) |
Au coin du feu, je me suis assoupi, un
livre de fantômes sur les genoux. A défaut d’avoir percé tous les
secrets du royaume des ombres, je laisse vagabonder mon imagination au
royaume des rêves.
Bonnes fêtes à tous !
O.V.
Remerciements : Damien Caillard,
initiateur de ce voyage
*****************************************************************
>>
Pour organiser votre visite :
Les Etangs de Commelle et le château de
la Reine Blanche
Accès par Coye-la-Forêt et la route des étangs
Site web :
http://www.coyelaforet.com/zone/listeLieux00010065.html
Le château de Chantilly
Site web :
http://www.chateaudechantilly.com/
La chapelle royale de Saint-Frambourg,
Senlis
Site web de la Fondation Cziffra :
http://www.fondation-cziffra.org/
Le château de Raray
Site web :
http://www.chateau-raray.com/
Le château de Pierrefonds
Un site web non official :
http://perso.wanadoo.fr/espace-libre/pierrefonds.html
>>
Où loger ?
Hôtel Restaurant*** A la Bonne Idée,
Saint-Jean-aux-Bois
Site web :
http://www.a-la-bonne-idee.fr/
>>
Lire
Journal d’un chasseur de fantômes
(The Journal of a Ghosthunter)
Simon Marsden
Edition française épuisée
Disponible en anglais sur le
site du photographe
La Belle et la Bête, les coulisses du
tournage
Dominique Marny
Edition Le Pré aux Clercs
Novembre 2005
>>
Voir (ou revoir !) en DVD
La Belle et la Bête
Jean Cocteau
Edition Collector 2 DVD disponible en février 2006
Studio Canal
*****************************************************************
©
Crédits photographiques : O.V. |










