|
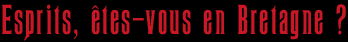
2ème partie du journal d'un chasseur de
fantômes bretons
Illustrations : O.V. (hommage à Simon Marsden)
Les secrets du Blavet
Quittons criques et caps, grèves et baies,
écueils et marées ! Quittons l’Armor, pays de la mer, pour entrer sur
les terres de l’Argoat. En suivant la route d’Auray à Pontivy par la
D768, nous mettons le cap sur Baud, ville pittoresque du centre du
Morbihan, aux portes du pays de Rohan que traverse le Blavet. Dans cette
région où les prairies épousent les courbes des collines, se nichent
d’étonnants lieux de culte : calvaires, statues, chapelles isolées et
fontaines sacrées. Les fantômes feraient-ils partis de ce patrimoine ?
 |
A l’entrée de Pluvigner, nous sommes
frappés par la présence d’un surprenant manoir, le château de Rimaison,
aux allures de maison hantée. Deux chats noirs et quelques corbeaux en
gardent l’entrée. Verrouillée par un gros cadenas, la grille nous
empêche d’accéder à la cour. De toute façon, un écriteau en bois indique
qu’il s’agit d’une propriété privée. Même déserte, il vaut mieux ne pas
enfreindre la loi, surtout à quelques pas d’un office notarial.
Cela ne nous empêche pas de prendre quelques photos. |
Une recherche ultérieure sur Internet nous apprendra
qu’il s’agit d’un manoir entièrement reconstitué dans les années 1950 à
partir de pierres provenant des ruines d’un ancien château médiéval de Bieuzy-les-Eaux laissé à l’abandon au 18ème siècle. Cette
anecdote permet de se poser la question : lorsqu’un lieu hanté est
démantelé et reconstruit ailleurs, les fantômes subsistent-ils à cette
délocalisation ?
La mystérieuse statue de
Quinipily
A Baud où l’eau sacrée par de saints
guérisseurs comme Notre-Dame-de-la-Clarté (vénérée pour les troubles de
la vue) ou Saint Adrien (invoqué pour les maux de ventre) contribue à la
notoriété des environs, nous prenons la D724 et suivons les panneaux
« Venus de Quinipily ». A environ 1,5 km du bourg, en direction de
Hennebont, une petite route se détache sur la gauche. Un vieux portail
marque la voie d’accès (interdite au public) à un ancien château dont
les ruines, envahies par la végétation, sont désormais inaccessibles.
Cependant, en continuant la petite route sur 500 m, on tombe sur
l’ancienne porte monumentale de Quinipily. L’enceinte est aujourd’hui
occupée par une ferme privée appartenant à la descendante du Comte de
Lannion. Pour 2,50 euros par personne, on peut accéder au site sur
lequel est implantée la statue d’une déesse antique, la Venus de
Quinipily (7).
|
Son énigmatique histoire avait attisé
notre curiosité. Nous voulions donc voir de plus près celle qui a
déchaîné les passions pendant des siècles. Jusqu’au 12ème siècle, elle
se dressait à une douzaine de kilomètres plus au nord, sur la colline de
Castennec, où s’élevait jadis une cité gauloise, Sulim. Connue alors
sous les appellations de « femme de fer », Vierge ou sorcière de la
Garde (du nom de l’ancien oppidum de Castennec, Guarda), elle
était vénérée par les paysans du coin. Ce qui inquiéta l’évêque de
Vannes, Charles de Rosmadec, au point de la faire jeter dans le Blavet
en 1661 par le Seigneur de Quinipily, Claude de Lannion. Repêchée trois
ans plus tard, son culte reprenait de plus belle. Loin d’être vaincu,
l’évêque ordonna sa destruction en 1670. Mais les ouvriers chargés de la
tâche se contentèrent de la remettre à l’eau après lui avoir entamé un
bras et un sein. |
 |
La statue fut définitivement sauvée en
1696 par le Comte Pierre, fils de Claude de Lannion, qui la fit
rechercher, retailler et installer dans son château à l’emplacement où
elle se trouve aujourd’hui. Les paysans de Castennec crièrent au vol et
un procès fut intenté par le duc de Rohan pour la récupérer. L’affaire
dura quelques années et fut tranchée par les juges : elle resterait à
Quinipily.
D’après les archéologues, la dénomination
de Vénus fut tout à fait contestable.
 |
Associée en 1812 à une déesse
égyptienne par un certain Maudet de Penhouët, auteur des "Antiquités
égyptiennes dans le département du Morbihan", elle devint tantôt
romaine, tantôt gauloise, entre le 19ème et le 20ème
siècle. Elle fut même accusée d’être un "faux", remplacée en 1696 lors
de sa taille forcée, par une copie créée de toutes pièces par Pierre de
Lannion. Cette thèse était d’autant plus crédible que les inscriptions -
aux caractères tous identiques ! - relevées sur le socle furent
attribuées à une mystification de la part du Comte. Supputation
indéfendable ! Comment une supercherie aurait pu tenir en haleine le duc
de Rohan pendant des années de coûteux procès ? L’hypothèse unanime en fait une déesse
adorée par les légionnaires en garnison à Sulim. Connaissant le culte
qu’ils rendaient à Isis, il s’agirait donc d’une effigie de la déesse
égyptienne. |
La visite vaut le coup d’œil pour la
quiétude et le charme d’un lieu que l’adorable gardienne fleurit
consciencieusement avec l’appui de la propriétaire. Les nombreuses
perspectives font l’objet de plusieurs photos. Point de fantôme à
Quinipily mais assurément l’âme de Vénus, déesse de la beauté, qui
enchante nos sens.
Zones interdites
La promenade romantique sera d’ailleurs au
programme du jour. Soumis aux caprices du temps, nous égrenons les
bourgs isolés, les chapelles (souvent fermées !), les calvaires, les
fontaines et les jolies chaumières bretonnes. En contrebas de la route,
le Blavet trace sa course à travers les bois. La Bretagne est aussi
hantée par la ferveur rurale dédiée à des protecteurs d’outre-tombe.
 |
Un manoir typiquement breton datant du 17ème
siècle a alerté notre attention. Situé au nord-est de Quistinic, sur la
D159, le manoir de Villeneuve-Jacquelot servit de décor au film
« Chouans ! » de Philippe de Broca. Un message téléphonique laissé sans
réponse a eu raison de notre visite (8). Nous apercevons ses tourelles
au détour d’un virage. Difficile de s’en approcher sans y avoir été
invité. C’est donc en parfaite violation des règles de bienséance que
nous parvenons aux grilles de l’édifice pour contempler ce bel exemple
d’habitat breton. Mais nous restons néanmoins à l’écart, le temps de
quelques photos, pour laisser nos fantasmes investir ce lieu mystérieux.
Nous ne verrons pas le superbe escalier de la grande tour, ni le
cloître. Encore une maison qui gardera jalousement son secret... |
Les guides touristiques racontent qu’une
chapelle privée datant de 1638 et surplombant la vallée s’élève sur une
butte à 500 m du château : Notre-Dame du Cloître. Le nom (claustra
ou barrière) et la position dominante de cette chapelle semblent porter
le témoignage d’une présence militaire romaine au 1er siècle.
Elle abriterait plusieurs statues dont celle en plâtre de Sainte
Marguerite sortant du dragon qui l’avait dévorée et invoquée pour
l’heureuse délivrance des femmes en couches.
Pendant la seconde guerre mondiale, la
chapelle fit office d’infirmerie pour les résistants du maquis. Mais le
secret fut éventé par un espion à la solde des allemands et le 24 juin
1944, les patriotes en planque furent tous massacrés par la milice.
Non loin de là, dans la forêt de Quistinic,
on raconte qu’une femme originaire de Penhars, près de Quimper, aperçut
le fantôme d’une femme sans tête alors qu’elle ramassait du bois mort
près d’un vieux châtaignier. Lui assurant venir de la part de Dieu et
non du diable, l’apparition déclara être ici « pour une pénitence
jusqu’à ce qu’une âme charitable l’ait délivrée d’un secret ». Le
spectre ne voulut pas en dire davantage et donna rendez-vous à Anna
Tanguy sur le pont de Trohir, le lendemain, à minuit sonnant.
De retour chez elle, Anna raconta son
aventure à une voisine et la pria de l’accompagner au lieu de
rendez-vous. Hélas, sous-estimant le temps de parcours, elles arrivèrent
en retard. Très peinée de ne pas avoir respecté sa promesse, Anna fit
donner une messe à son intention. Le soir même, alors qu’elle allait se
coucher, elle entendit une voix familière l’appeler par son nom. C’était
la femme sans tête qui voulait lui remettre quelque chose. Anna lui fit
déposer devant chez elle, sans la recevoir. C’est alors que le spectre
disparut en déclarant : « Dieu vous bénisse ! Vous m’avez soulagée de
mon fardeau. »
Bien inspirée d’avoir évité le revenant
cette fois-ci, Anna comprit qu’elle aurait dû prendre sa place au
royaume des morts, ainsi frappée par la malédiction que lui apportait la
femme sans tête...
Les spectres d’Auray
L’heure tourne et le jour touche à sa fin.
Sur la route du retour, nous passons par Auray pour rejoindre le Champ
des Martyrs. A l’ouest du marais de Kerzo s’étend une plaine qui fut, à
plusieurs reprises, le théâtre d’effusions de sang.
La première bataille se déroula le 29
septembre 1364 et marqua la fin de la guerre de succession de Bretagne
où s’affrontèrent sans merci les troupes de Jean de Montfort, futur duc
Jean IV soutenu par les Anglais, et celles de Charles de Blois, appuyé
par de nombreux seigneurs français. Blessé à mort par une dague
anglaise, Blois y succomba alors que Du Guesclin fut fait prisonnier. Sa
mort précipita la défaite des Français. Or, touché par l’extrême piété
de son adversaire, Jean de Montfort fit ériger une collégiale à la
mémoire de son ennemi à l’endroit même où ce dernier tomba. Servant de
couvent à des chartreux de 1483 à la Révolution, la collégiale dédiée à
l’archange Saint Michel est devenue une institution pour jeunes filles
sourdes, muettes et aveugles.
Le second carnage porte sur la cause
chouanne. Dans la chapelle de la chartreuse d’Auray sont gardés
aujourd’hui les ossements de 350 émigrés fusillés en 1795. Un mausolée
porte les noms des 952 chouans exécutés par les « Bleus » après l’échec
du débarquement royaliste à Quiberon.
|
En outre, une chapelle expiatoire
marque l’emplacement de la tragédie sur le « champ des Martyrs ». En 1815, un troisième et dernier bain de
sang opposa les Chouans et les troupes de Napoléon. Au vu de ce passé tragique, on comprend
mieux les histoires de fantômes qui circulent sur les environs du marais
de Kerzo et de la chartreuse d’Auray. Ces lieux seraient hantés par les
spectres des combattants morts en état de péché mortel lors de
l’engagement de 1364. Ils errent la nuit, sur le champ de bataille, et
frappent quiconque se trouve sur leur chemin. Plusieurs habitants du
coin auraient succombé à cette malédiction. Parfois, la proximité du
marais plonge les environs dans une brume sinistre, signe évident de
hantise. |
 |
Le piège de Saint-Cado
Avant de quitter la Haute-Bretagne pour
laisser l’Ankou à sa funeste mission, nous ferons un dernier crochet par
l’îlot de Saint-Cado, dans la Rivière d’Etel, près de Belz, pour finir
sur une anecdote plus diabolique.
 |
Doté d’une jolie chapelle romane, le
hameau de Saint-Cado est relié à la terre par une digue de pierres dont
l’origine remonte, selon la tradition, à la venue d’un moine qui lui
laissa son nom. Il aurait convenu avec le diable la construction d’un
passage entre l’île et la rive contre l’âme du premier vivant qui
l’emprunterait. Le travail presque achevé, Saint Cado y envoya un chat
et Satan fut dupé. De rage, il lâcha les dernières pierres dans la
rivière d’Etel, donnant ainsi naissance au pont Lorois.
Outre la chaussée qu’il disputa au diable,
Saint-Cado conserve les vestiges du lit de son fondateur. L’usage veut
que les sourds qui s’allongent dessus pour appliquer leur oreille contre
le fond d’une ouverture recouvrent miraculeusement l’ouïe. En outre, les
« bien-entendants » peuvent y percevoir un bourdonnement comparable à
celui de la mer dans un coquillage... |
L’heure des fantômes
En Armorique, la mort ne frappe pas à
l’improviste. Ceux qui sont attentifs au moindre signe peuvent s’y
préparer. Dans les campagnes bretonnes, le culte des morts est
particulier. Des présages, appelés intersignes, ont coutume
d’annoncer l’imminence d’un décès.
Parmi ces signifiances, on compte
entre autres une chouette qui vient frapper trois coups d’ailes sur la
vitre de la fenêtre, un chien qui hurle longuement pendant la nuit, une
chandelle de suif qui s’éteint subitement dans la cheminée, une illusion
d’enterrement qui traverse la lande, une procession de fantômes passant
la porte d’un cimetière ou, encore, une messe blanche célébrée la nuit
près d’une chapelle en ruine par un prêtre trépassé en présence des
défunts de la paroisse.
Lorsque la mort frappe, le chef de famille
arrête le balancier de l’horloge pour marquer l’heure du décès. A la
veillée, on récite le chapelet et assiste à de copieuses libations. Une
prière de circonstance est psalmodiée d’une voie larmoyante par le
récitant et reprise par l’assemblée : « Par où qu’il est passé,
j’passerons. Ah ! Mon Dieu, la triste affaire ! Il est mort ! Il n’est
plus ! La triste affaire ! N’en parlons plus ! ».
Moralité : Ne cherchez pas trop les
fantômes en Bretagne. Ils ne sont pas toujours là où on aimerait les
voir. Et si on les croise, votre heure est sans doute venue...
Caroline et Olivier Valentin
>>
Retour 1ère partie du journal d'un chasseur de
fantômes bretons
*****************************************************************
(7) La Vénus de
Quinipily et ses jardins : ouvert de mai à octobre t.l.j. de 10h à 19h
et de novembre à avril t.l.j. sauf mardis de 11h à 17h. Fermé du 15
décembre au 2 janvier.
(8) Après vérifications ultérieures, le
numéro de téléphone mentionné dans notre guide (Bretagne Sud, Guides
bleus Hachette, p.291) n’est pas le bon. Ce qui explique que notre
message pour visiter la demeure soit resté « lettre morte ».
Maison-Hantee.com enquête actuellement auprès de la mairie de Quistinic
pour s’assurer que les visites sur rendez-vous sont toujours possibles.
Affaire à suivre...
*****************************************************************
Repères bibliographiques
>> « Bretagne des légendes » : Brochure
2005 éditée par le Comité Régional de Tourisme de Bretagne et disponible
gratuitement sur leur
site web
(textes de René Le Bihan, ancien Conservateur du Musée des Beaux-Arts de
Brest)
>>
Au
Pays de l’Oust à Brocéliande :
Magazine édité en janvier 2005 par le Pays Touristique de l’Oust à
Brocéliande (tél : 02 97 73 33 33)
>> Bretagne Sud, Guides Bleus Hachette,
2004
>> Guide de la Bretagne Mystérieuse, Les
Guides Noirs, Editions Tchou Princesse, 1979 (édition épuisée disponible
en occasion chez les bouquinistes et/ou sur Internet. Une nouvelle
édition est disponible depuis 2002 chez Coop Breizh)
*****************************************************************
©
Crédits photographiques : O.V. pour Maison-Hantee.com |










